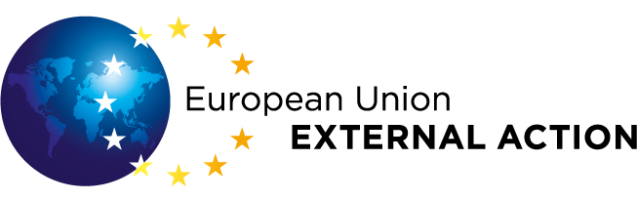Combattre les politiques basées sur les rapports de force à l’Est

«Nous devons continuer d’apporter une réponse lucide et ferme aux démonstrations de force dans notre voisinage oriental comme ailleurs. Celles-ci nous rappellent qu’il nous faut nous donner les moyens d’agir.»
Le renforcement des capacités militaires russes à la frontière ukrainienne, couplé à l’escalade des menaces et des actions subversives à destination de l’Ukraine, a dominé ces dernières semaines l’actualité et la diplomatie internationales. Il s’en est suivi un foisonnement d’activités à tous les niveaux et dans toutes les enceintes, qu’il s’agisse du G7, de l’OTAN ou de l’OSCE, ainsi que sur le plan bilatéral. Il va de soi que ces sujets se sont aussi invités au cœur de la politique étrangère de l’UE cette semaine, à commencer par lundi, lors de la réunion des ministres des affaires étrangères de l’UE, mardi, à l’occasion des débats du Parlement européen, puis mercredi, au cours du sommet du partenariat oriental, et enfin jeudi, durant le Conseil européen.
Dans le même temps, il nous a encore fallu faire face aux retombées de la crise en Biélorussie. Grâce à la souplesse de la diplomatie européenne, le flux de migrants irréguliers attirés pour de fausses raisons avant d’être poussés vers la frontière s’est désormais tari. Mais même si nombre d’entre eux ont été rapatriés vers leur pays d’origine (plus de 4 000 personnes sont ainsi retournées par avion en Iraq), plusieurs milliers demeurent bloqués en Biélorussie et ont besoin d’une aide humanitaire. Pendant ce temps, la répression interne exercée en Biélorussie se poursuit sans relâche.
Les deux crises se déroulent dans un climat de fortes tensions avec la Russie et dans un contexte marqué par un niveau exceptionnellement élevé des prix de l’énergie, les prix du gaz ayant augmenté d’environ 40 % au seul mois de décembre et d’environ 300 % depuis l’été. Toute discussion relative à la Russie, à l’Ukraine ou à la Biélorussie ne peut faire abstraction de la dimension énergétique, du fait que 40 % des importations de gaz de l’UE proviennent de Russie et empruntent principalement les trois itinéraires de transit suivants: l’Ukraine, la Biélorussie et la mer Baltique.
La Russie se sert de l’énergie comme d’un outil au service de son influence politique (en Moldavie, par exemple), et si le pays satisfait, stricto sensu, à ses obligations en matière d’approvisionnement en gaz, d’aucuns voient dans son refus actuel d’augmenter le volume de ses exportations vers l’Europe ou de reconstituer les réserves des installations de stockage détenues par Gazprom le moyen de faire pression sur l’UE en vue, en particulier, d’assurer l’octroi d’une licence réglementaire à Nord Stream 2. Ce projet, que la Commission européenne ne juge pas prioritaire et qui, en tout état de cause, devra satisfaire aux exigences réglementaires européennes, continue de faire l’objet de discussions, faisant ainsi la preuve que la solidarité est une voie à double sens. Nul ne saurait accroître sa propre sécurité sans tenir compte de la sécurité de l’ensemble de l’Union, ce qui devrait constituer un principe de base permettant à l’Europe de se renforcer et de contrer les tentatives destinées à nous diviser.
Toutes ces évolutions se sont invitées de concert au Conseil des affaires étrangères, aux débats du Parlement européen et au sommet du Conseil européen.
De quoi a-t-il donc été question et où en sommes-nous à présent?
En ce qui concerne l’Ukraine, tout le monde s’accorde sur la nécessité, pour l’heure, de faire preuve de fermeté et d’unité, en dissuadant la Russie d’opérer d’éventuels mouvements supplémentaires. Nous devons défendre les principes fondamentaux sur lesquels repose la sécurité européenne et qui sont, de plus, consacrés par la Charte de Paris de 1990 et par l’Acte final d’Helsinki de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (CSCE/OSCE), tous deux signés par la Russie: la souveraineté et l’intégrité territoriale des États, l’inviolabilité des frontières reconnues au niveau international et la liberté des États de décider des modalités de leur politique étrangère et de sécurité. Le Conseil européen est convenu d’envoyer aux dirigeants russes un message fort décrétant que toute action entreprise contre l’Ukraine et ces principes, par des moyens tant militaires qu’hybrides, aurait de graves conséquences.
«Nous avons bien conscience du fait que des mots et des déclarations ne suffisent pas à eux seuls à infléchir la ligne suivie par les dirigeants russes.»
Les véritables intentions du Kremlin sont loin d’être claires, si ce n’est la volonté de menacer et d’affaiblir l’Ukraine. Divers scénarios sont envisageables. Ainsi que je l’ai annoncé au Parlement européen de Strasbourg, nous devons espérer le meilleur, tout en nous préparant au pire. Nous ne pouvons exclure l’hypothèse selon laquelle la Russie entend se servir de cette crise comme d’un levier aux fins de la réalisation de son objectif déclaré consistant à remodeler le cadre de la sécurité en Europe, en excluant par la même occasion les Européens des discussions. Nous savons cependant que nos alliés américains ne tomberont pas dans ce piège.
Nous avons bien conscience du fait que des mots et des déclarations ne suffisent pas à eux seuls à infléchir la ligne suivie par les dirigeants russes et c’est pourquoi il est si important que les dirigeants européens aient décidé de reconduire les sanctions économiques actuelles et averti que tout mouvement russe en direction de l’Ukraine serait lourd de conséquences. Un message souligné à la fois par le président du Conseil et la présidente de la Commission. Et il s’agit là d’une mission importante pour moi, en ma qualité de HR/VP, car, conformément au traité, les décisions relatives à l’adoption, à la prolongation ou à la levée de régimes de sanctions sont prises par le Conseil (et donc par les États membres), sur la base de propositions du haut représentant. La Commission européenne a par conséquent un rôle essentiel à jouer pour donner effet à ces sanctions et en en supervisant la mise en œuvre par les États membres.
«La diplomatie est plus efficace lorsqu’elle se fait en partenariat avec d’autres acteurs et c’est pourquoi nous n’avons cessé d’être en contact étroit avec les États-Unis et d’autres partenaires partageant les mêmes valeurs que nous.»
Il importe également de se souvenir que l’UE collabore depuis des années avec l’Ukraine, y compris par exemple par l’intermédiaire de sa mission de conseil (lien externe) sur la réforme du secteur de la sécurité civile, dans le cadre de notre politique de sécurité et de défense commune. Nous avons récemment ajouté, dans le cadre de la facilité européenne pour la paix, un ensemble d’aides à l’armée ukrainienne d’un montant de 31 millions d’EUR et concernant la fourniture d’un soutien sanitaire aux forces armées et d’un appui en matière de cyberdéfense.
La diplomatie est plus efficace lorsqu’elle se fait en partenariat avec d’autres acteurs et c’est pourquoi nous n’avons cessé d’être en contact étroit avec les États-Unis et d’autres partenaires partageant les mêmes valeurs que nous, dont les ministres des affaires étrangères du G7, en vue de faire passer un message uni de soutien à l’Ukraine, tout en dissuadant la Russie d’entreprendre de nouvelles actions.
De nombreux dirigeants de l’UE ont mis en avant la nécessité de poursuivre cette coordination et de soutenir les efforts diplomatiques.
J’ai aussi insisté, naturellement, pour que l’UE soit conviée à toute discussion concernant l’architecture de sécurité européenne. Vendredi dernier, le ministre russe des affaires étrangères a publié un projet de proposition de garanties en matière de sécurité entre la Russie, les États-Unis et les membres européens de l’OTAN. Il est indispensable que l’UE fasse partie intégrante de telles discussions. Au cours de ces cinquante dernières années, l’Acte final d’Helsinki et la Charte de Paris nous ont offert des principes essentiels autour desquels nous avons pu édifier la sécurité européenne. L’OSCE, en particulier, propose des mécanismes et des règles qui demeurent la clef de voûte de tout dialogue avec la Russie.
«Notre contentieux avec la Biélorussie ne se borne pas à son instrumentalisation flagrante des migrants. Loin s’en faut.»
Pour ce qui est de la Biélorussie, la phase aiguë de la crise à la frontière avec l’UE est à présent passée. Toutefois, le contentieux avec la Biélorussie ne se borne pas à son instrumentalisation flagrante des migrants. Loin s’en faut. C’est le caractère répressif, brutal et illégitime du régime de Loukachenko qui est à l’origine du problème, plus de 900 prisonniers politiques croupissant actuellement dans les geôles du pays. Mardi dernier, le régime a condamné à la peine absurde de 18 ans de prison le mari de Svetlana Tsikhanovskaya, leader de l’opposition en exil.
Le 12 décembre, avec Charles Michel, le président du Conseil européen, j’ai organisé une réunion avec des représentants de la Biélorussie démocratique – des membres de la société civile et des militants d’ONG, des défenseurs des droits de l’homme, des blogueurs et des membres de l’opposition politique. J’ai été impressionné par leurs histoires et leur détermination. Ils ont demandé que l’UE continue à soutenir un changement démocratique et à maintenir la pression sur le régime. L’UE a récemment adopté une 5e série de sanctions visant non seulement les personnes ayant participé à l’organisation de ce cynique trafic de migrants, mais aussi celles qui tirent les ficelles de la répression constante et que l’on surnomme les «valets de Loukachenko». Le régime biélorusse continuera de soutenir d’autres régimes aux vues similaires, comme celui de Maduro, au Venezuela. Ces deux régimes illégitimes ont signé de nouveaux accords de coopération et s’épaulent mutuellement.
Les tensions régionales et les actions de déstabilisation orchestrées par la Russie ont également été au cœur des discussions du sommet du partenariat oriental qui s’est tenu mercredi dernier, juste avant le Conseil européen. Nous y avons rencontré les dirigeants de l’Ukraine, de la Géorgie, de la Moldavie, de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan, un siège étant laissé libre pour la Biélorussie à titre tristement symbolique. Le sommet s’articulait autour du triptyque «reprise, résilience et réforme», l’UE proposant un plan économique et d’investissement régional d’un montant de 2,3 milliards d’EUR susceptible de mobiliser jusqu’à 17 milliards d’EUR d’investissements.
Nous savons naturellement que les positions et degrés d’ambition concernant un rapprochement avec l’UE – et ce qu’elle représente – varient parmi les pays du partenariat oriental et qu’un certain niveau de différenciation est dès lors nécessaire, tout en veillant à préserver l’inclusivité globale du groupe.
Lors du sommet, nous sommes convenus d’intensifier le partage des vaccins, de renforcer l’état de droit et d’approfondir notre coopération en matière de sécurité (voir, par exemple, les mesures d’appui prises récemment dans le cadre de la facilité européenne pour la paix en faveur de la Géorgie, de la Moldavie et de l’Ukraine). Nous avons également signé un nouvel accord de financement pour un montant de 60 millions d’EUR en vue d’aider la Moldavie à faire face aux conséquences de la crise du gaz.
«Il a été frappant de voir le Premier ministre arménien et le président azerbaïdjanais, dont les pays ont connu un conflit militaire ouvert, converser de manière constructive lors du sommet du partenariat oriental, plutôt que de choisir la confrontation directe.»
La discussion, qui allait au-delà des formalités diplomatiques généralement de mise lors de ce genre de réunions en se caractérisant par une grande ouverture, a confirmé que nos partenaires du voisinage oriental étaient très demandeurs d’une coopération et d’une intégration accrues avec l’UE, cette dernière étant disposée à satisfaire ces demandes en faisant en sorte de réaffirmer son rôle d’acteur géopolitique de poids dans la région.
Il a été frappant de voir le Premier ministre arménien et le président azerbaïdjanais, dont les pays ont connu un conflit militaire ouvert, converser de manière constructive lors du sommet du partenariat oriental, plutôt que de choisir la confrontation directe. Cela a été rendu possible grâce aux efforts de médiation déployés par le président Michel, qui avait organisé la veille au soir une réunion à la fois intense et fructueuse avec les deux dirigeants. Je me félicite des résultats de cette rencontre et de la détermination des deux parties à mettre en route des idées et des projets concrets pouvant ouvrir la voie à la réconciliation. Cette réunion a mis en lumière la volonté de l’UE de coopérer étroitement avec l’Arménie et l’Azerbaïdjan afin de tourner la page du conflit, de créer des coopérations et une atmosphère de confiance, ainsi que d’instaurer une paix durable dans la région; elle a aussi montré que l’UE était prête à jouer un rôle accru dans les efforts consentis en vue d’un règlement du conflit dans le Caucase du Sud.
«Ces nouveaux développements démontrent combien il est urgent que l’UE renforce ses capacités et ses moyens d’action dans le domaine de la sécurité.»
Le second grand thème abordé dans le cadre des relations extérieures lors de ce Conseil européen a été celui de la boussole stratégique, que j’ai présentée aux États membres le mois dernier. J’ai entamé mon avant-propos par une phrase lourde de sens: «L’Europe est en danger». Les crises en Ukraine et en Biélorussie sont les parfaites illustrations, s’il en était besoin, du genre de menaces auxquelles l’Europe est confrontée: tactiques hybrides, politiques basées sur les rapports de force, intimidation et désinformation. Outre le sort de nos différents pays et sociétés, ce sont aussi les grands principes sur lesquels repose l’ordre de sécurité européen qui sont ici en jeu.
Ces nouveaux développements démontrent combien il est urgent que l’UE renforce ses capacités et ses moyens d’action dans le domaine de la sécurité. Nos États membres doivent disposer de capacités de défense renforcées et capables d’une plus grande interopérabilité. Cela contribuera aussi aux efforts consentis par l’OTAN en vue de la protection de nos frontières orientales et renforcera notre capacité collective en matière de déploiement et de projection.
J’ai fait part aux dirigeants de l’état d’avancement de la boussole stratégique et souligné la nécessité de nous montrer ambitieux et de nous concentrer sur les résultats, plutôt que de nous fourvoyer dans des délibérations idéologiques. Fondamentalement, la boussole n’est pas qu’un descriptif des menaces et des défis qui se posent à nous, mais bien un guide pratique. Elle comprend des propositions concrètes, de plus ou moins grande envergure, assorties d’objectifs et d'échéances clairs visant à mesurer les progrès accomplis.
Il va sans dire que les propositions figurant dans la boussole, qui visent à constituer des équipes d'intervention en cas de menaces hybrides, ainsi qu’à se donner les moyens de renforcer notre capacité à faire face à des cybermenaces et à des campagnes de désinformation agressives, de même que les options visant à améliorer la résilience et la sécurité de nos partenaires à l’aide de formations et d’équipements, sont plus que jamais d’actualité au vu des crises récentes.
«Les démonstrations de force, dans notre voisinage oriental comme ailleurs, constituent un défi fondamental. Nous devons continuer d’apporter une réponse lucide et ferme et nous donner les moyens d’agir.»
Quant à la boussole, j’ai été heureux de constater que les dirigeants de l’UE étaient d’accord avec le diagnostic posé et avec le sentiment d’urgence qui est le nôtre. Il appartient aux États membres de décider des étapes suivantes: ce sont eux, en effet, qui détiennent les moyens et qui prennent les décisions. Ils ont fait leur ma quête d’ambition accrue et de résultats exploitables. En janvier, je présenterai une version actualisée de la boussole stratégique lors de la réunion informelle des ministres des affaires étrangères et de la défense de l’UE à Brest, afin de tenir l’objectif de son adoption en mars.
Les démonstrations de force, dans notre voisinage oriental comme ailleurs, constituent un défi fondamental. Nous devons continuer d’apporter une réponse lucide et ferme et nous donner les moyens d’agir.
MORE FROM THE BLOG

"Une fenêtre sur le monde" - Blog du HR/VP Josep Borrell
Blog de Josep Borrell sur ses activités et la politique étrangère européenne. Vous pouvez également y trouver des interviews, des articles d'opinion, une sélection de discours et de vidéos.