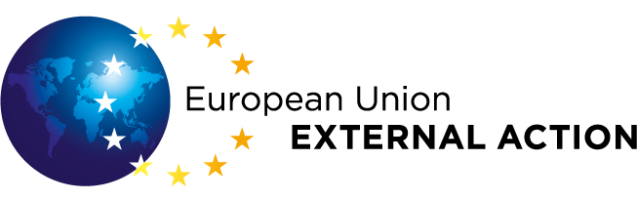La menace terroriste s’étend au Sahel
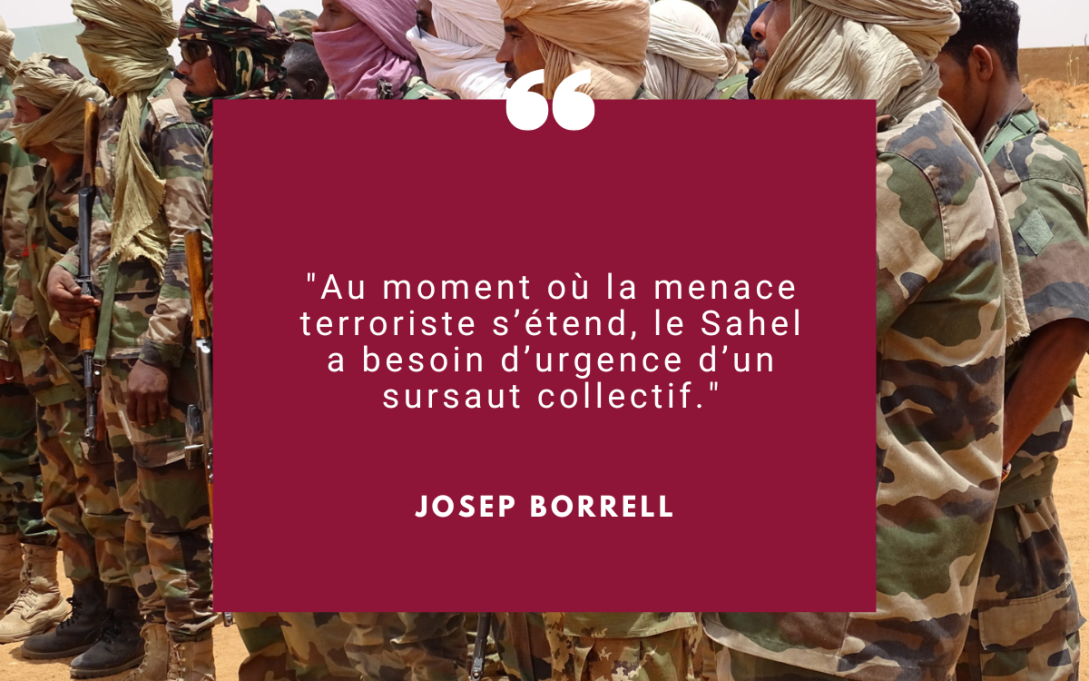
Depuis une décennie maintenant, l’Union européenne est engagée au Sahel aux côtés de ses partenaires africains et internationaux afin de lutter contre le terrorisme. Ce combat est bien sûr d’abord une affaire africaine, mais il concerne aussi l’Europe et le monde. En effet la déstabilisation du Sahel par les terroristes constitue une menace directe pour l’Union non seulement en matière de sécurité et de terrorisme mais aussi dans de nombreux autres domaines comme les trafics en tout genre. C’est pourquoi, depuis le début de mon mandat, je me suis personnellement impliqué dans ce dossier, notamment en visitant la région en avril 2021.
Au moment où les derniers soldats de la force Barkhane, déployée par la France, quittent le Mali, la situation s’est fortement dégradée sur le terrain ces dernières semaines, avec la multiplication d’attaques terroristes touchant tant des militaires que des civils. Au-delà de leur bilan humain particulièrement lourd, notamment récemment pour l’armée malienne, c’est à la fois l’extension géographique croissante de ces attaques et les modes opératoires de plus en plus sophistiqués utilisés par les terroristes qui doivent nous alarmer.
« Au-delà de leur bilan humain particulièrement lourd, c’est à la fois l’extension géographique croissante des attaques terroristes et leurs modes opératoires de plus en plus sophistiqués qui doivent nous alarmer. »
En effet, au Sahel mais aussi désormais dans les pays du Golfe de Guinée, les terroristes visent de plus en plus à isoler les populations des capitales des pays de la région comme l’avaient montré l’explosion des ponts de Woussé et de Naré au Burkina Faso en juillet dernier. Les axes routiers reliant Niamey, capitale du Niger, et Ouagadougou, capitale du Burkina Faso ne sont plus sécurisés, or ce sont eux qui assurent les principales connexions depuis et vers les pays du golfe de Guinée. L’isolement à la fois symbolique, politique et matériel des populations est renforcé et elles deviennent de ce fait un terreau plus aisé pour leur recrutement par les mouvements terroristes.
Cette dégradation trouve tout d’abord son origine dans la mise à l’écart progressive des acteurs africains et internationaux dont le mandat est précisément d’aider à rétablir la paix et la sécurité dans la région. Elle confirme ensuite l’échec d’une stratégie purement sécuritaire : la lutte contre le terrorisme ne peut pas se gagner uniquement sur le terrain militaire. Comme je l’ai dit à de nombreuses reprises, pour gagner cette guerre il faut aussi gagner la paix.
Un affaiblissement continu de la coordination régionale et internationale
La dégradation de la situation sécuritaire résulte en particulier de l’échec de la politique menée par les autorités maliennes issues des coups d’Etat de 2020 et 2021 : des États fragiles ne sont jamais renforcés par des transitions longues. Le G5 Sahel, créé en 2014 pour coordonner l’action des autorités de la Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Tchad, n’a cessé d’être affaibli ces derniers mois. Le retrait du Mali, annoncé en mai dernier, a porté à cette organisation un coup presque fatal alors même que la coordination régionale reste le fondement indispensable d’une lutte efficace contre le terrorisme et pour le développement du Sahel.
La Mission Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA), mise en place par le Conseil de Sécurité en 2013, n’a cessé elle aussi d’être fragilisée. Du fait de l’attitude des autorités de transition maliennes, elle ne peut mettre en œuvre le nouveau mandat qui lui a été confié par le Conseil de Sécurité en juin dernier : ces autorités ont interdit en effet aux Casques bleus de pénétrer sur certaines parties du territoire – en particulier celles où des exactions ont été commises par les Forces armées maliennes et les mercenaires russes de Wagner. Elles ont procédé de plus en juillet dernier à l’arrestation de 49 soldats ivoiriens toujours détenus pour des motifs obscurs. Malgré les tentatives de médiation, des Nations Unies ou de la Présidence de l’Union africaine, les autorités maliennes viennent de les inculper de « tentative d’atteinte à la sûreté de l’Etat ». Pendant les premiers jours d’août, ces autorités de transition avaient demandé également le retrait des hélicoptères espagnols et allemands utilisés par la MINUSMA et la mission d’entraînement de l’UE. En conséquence, l’Allemagne avait dû suspendre provisoirement sa participation à la MINUSMA.
« L’efficacité du dispositif antiterroriste est minée par l’action de mercenaires privés étrangers qui s’illustrent davantage par leurs exactions à l’encontre des populations civiles que par leur capacité à se battre efficacement contre les djihadistes. »
Nos missions européennes EUTM Mali et EUCAP Sahel Mali, qui ont formé environ 18 000 soldats maliens depuis 2013 (soit la moitié des effectifs militaires du pays), subissent elles aussi une mise à l’écart croissante de la part des autorités de transition. Enfin, le retrait de la force Barkhane, déployée par la France, et de la force Takuba, associant des soldats des forces spéciales de 9 pays européens, vient compléter le tableau d’un dispositif de lutte contre le terrorisme très affaibli. L’efficacité de ce dispositif est minée de plus par l’action de mercenaires privés étrangers qui s’illustrent davantage par leurs exactions à l’encontre des populations civiles que par leur volonté et leur capacité à se battre efficacement contre les djihadistes.
Les limites du « tout militaire »
Ce que rappelle aussi la multiplication des attaques terroristes au Sahel ces derniers mois, c’est l’échec d’une stratégie de lutte contre le terrorisme, fondée sur une réponse principalement militaire. Pour notre part nous avions déjà acté un tel échec : pour être durable, tout gain militaire doit impérativement être consolidé par des actions bénéficiant aux populations les plus vulnérables. C’est valable au Sahel, mais aussi ailleurs dans le monde. C’était le sens du « sursaut civil et politique » que nous avions décidé avec nos partenaires sahéliens avant que les coups d’Etat ne viennent mettre à mal ce tournant stratégique.
« Au Sahel, il faut s’attaquer au terrorisme autant qu’à ses causes profondes, à savoir la faiblesse de l’Etat de droit et l’absence des services de base pour tous, sur l’ensemble du territoire. »
La lutte contre le terrorisme telle que l’UE l’entend et l’accompagne au Sahel doit en effet s’attaquer au terrorisme autant qu’à ses causes profondes, à savoir la faiblesse de l’Etat de droit et l’absence des services de base pour tous, sur l’ensemble du territoire. Il s’agit à n’en pas douter d’une tâche de longue haleine. Renforcer notre soutien à des programmes focalisés sur l’accès aux services de base et remettre ce sursaut civil et politique au cœur de la lutte contre le terrorisme en soutenant des transitions politiques crédibles et des autorités légitimées démocratiquement, telle est la priorité de l’action européenne dans la région.
Cette approche n’est certainement pas celle des mercenaires privés de Wagner. Les actions « coup de poing » conduites par les forces armées maliennes et les mercenaires russes de Wagner qui les assistent paraissent pensées et exécutées comme des expéditions punitives contre certaines populations. Ce qui ne peut qu’alimenter, au Sahel comme ailleurs, un cycle de violences et de représailles sans fin.
La lutte contre le terrorisme ne s’improvise pas, pas plus qu’elle ne peut se déléguer à des mercenaires aux motivations obscures. Les événements des dernières semaines nous l’ont rappelé avec acuité.