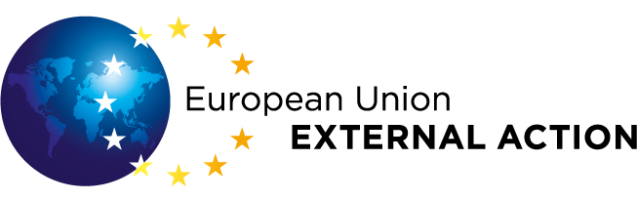Le Monde - Josep Borrell : « Wagner en Afrique est devenue la garde prétorienne des dictatures militaires »

Publié originellement par Le Monde (Mathilde Boussion). Disponible ici: https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/01/30/josep-borrell-wagner-en-afrique-est-devenue-la-garde-pretorienne-des-dictatures-militaires_6159884_3212.html
Josep Borrell est le haut représentant de la Commission européenne pour les affaires extérieures et la politique de sécurité. Du 26 au 29 janvier, il était en visite en Afrique du Sud et au Botswana. Dans un entretien au Monde, il revient sur la lutte d’influence qui oppose les Occidentaux à la Russie sur le continent africain depuis le début de la guerre en Ukraine.
Sergueï Lavrov était en visite à Pretoria quelques jours avant vous, ainsi que la secrétaire au Trésor américaine, Janet Yellen. L’Afrique est-elle redevenue le théâtre d’une lutte d’influence entre grandes puissances ?
Josep Borrell Oui, l’Afrique est sans doute un champ de bataille : une bataille de récits autour de la guerre en Ukraine. La Russie a clairement des appuis dans la région et elle mène une activité diplomatique intense. Nous essayons également d’expliquer les causes et les conséquences de cette guerre.
L’Afrique du Sud, qui s’abstient de condamner l’agression russe, est-elle au cœur de cette bataille ?
L’Afrique du Sud est un pays très important, un de nos partenaires stratégiques, et nous regrettons qu’elle ne soit pas du côté de ceux qui ont condamné l’invasion. Mais elle n’est pas seule dans la région. D’autres en revanche ont clairement condamné la violation de la Charte des Nations unies.
A l’issue de votre rencontre avec Naledi Pandor, ministre sud-africaine des affaires étrangères, vous vous êtes dit « irrité » par les « désaccords » avec l’Afrique du Sud…
Nous respectons les choix de politique étrangère de tous les Etats indépendants. Mais la première chose, si on part de ce principe, c’est que l’Ukraine a également le droit d’avoir les alliances qu’elle veut, ce que la Russie ne semble pas accepter. Ensuite, on comprend que l’Afrique du Sud puisse avoir des raisons historiques ou idéologiques de ne pas vouloir critiquer la Russie. Mais ne pas condamner l’invasion d’un pays en violation de la Charte des Nations unies, c’est autre chose. Si vous voulez être du côté de la Charte, vous devriez condamner une invasion. La position de neutralité de l’Afrique du Sud n’en est pas une.
Vous estimez que l’Afrique du Sud a pris le parti de la Russie ?
Si vous dites « nous sommes non alignés » tout en cajolant la Russie et en menant des manœuvres militaires avec elle, on commence à croire que vous n’êtes pas tellement non alignés. L’Afrique du Sud répond : « Nous faisons des manœuvres navales avec qui nous voulons. » Certainement, mais réaliser des manœuvres avec la Russie et la Chine le jour du premier anniversaire de la guerre en Ukraine a une valeur symbolique. Nous aurions préféré qu’ils ne le fassent pas.
L’Afrique du Sud joue sur les deux tableaux. L’Union soviétique les a aidés pendant la lutte contre l’apartheid et ils sont reconnaissants. Mais il y a aussi une dimension géopolitique qui consiste à dire : « Je suis une puissance régionale et je joue avec toutes les parties puisque, de toute façon, les Européens continueront à nous aider et à commercer avec nous, il n’y aura pas de conséquences. »
N’y a-t-il pas une contradiction à dire : « Vous faites ce que vous voulez… Mais vous devriez condamner cette agression » ?
Non, je reconnais l’indépendance et la liberté de choix mais je pense que c’est ce qu’ils devraient faire. Je dis « vous devriez », pas « vous devez ».
N’avez-vous pas peur de vous aliéner certains pays africains qui n’aiment pas avoir le sentiment d’être pressés ou critiqués pour leurs prises de position ?
Pressés, non. La preuve, nous n’avons pris aucune mesure punitive. Est-ce que nous disons : « Si vous faites ça, on vous coupe l’aide au développement ? » Non. Mais je l’ai dit devant le Parlement européen : on sait qui a appuyé la Russie à travers leur vote aux Nations unies et on s’en rappellera. Pour l’instant, ça n’a pas eu de conséquences, mais nous avons quand même le droit d’avoir notre avis. Ce n’est pas une guerre entre Européens, la question est celle du respect de la charte des Nations unies. L’Afrique du Sud dit la respecter, qu’elle le prouve.
Comment réagissez-vous à la décision du Burkina Faso, qui a demandé le retrait des troupes françaises et qui, selon plusieurs sources, s’est rapproché du groupe Wagner ?
D’un côté, le Le Burkina Faso veut armer 50 000 citoyens pour créer des milices populaires et envisage de faire appel à des mercenaires russes. De l’autre, il se passe des services d’une force organisée, efficace et respectueuse des droits humains qui serait un atout fondamental dans la lutte contre le terrorisme. Si le but est effectivement de défendre le pays face à la menace terroriste, on ne comprend pas bien la logique. Il doit y avoir d’autres raisons.
Est-ce que vous sous-entendez que le régime burkinabé se rapprocherait du groupe Wagner dans le but de se maintenir au pouvoir ?
Une fois de plus, c’est la décision d’un pays. Mais il faut reconnaître que la décision d’un pays dont le gouvernement a été élu démocratiquement n’est pas la même chose que la décision d’un gouvernement issu d’une succession de coups militaires. Wagner est devenue la garde prétorienne des dictatures militaires.
Faire appel au groupe Wagner pourrait-il avoir des conséquences sur les relations de l’Union européenne avec les pays qui ont fait ce choix ?
C’est l’éternelle question. Si demain le Mali demande la fin de la mission de formation militaire de l’UE, nous partirons. Pour le moment, elle est toujours là… La formation des troupes est suspendue, mais la mission continue à mener des activités de conseil et de formation des cadres, dans la mesure où c’est possible. C’est très limité, les effectifs ont été réduits et nous pourrions les réduire encore.
On ne va pas entraîner des troupes maliennes qui vont se battre aux côtés des mercenaires russes et risquent de commettre des exactions sur les populations civiles. Il ne faudrait pas qu’on nous dise : « C’est vous qui avez préparé ces troupes au combat. » Nous pourrions prendre la décision de partir définitivement, certains Etats membres le demandent. D’autres estiment que tant qu’on peut avoir une influence, il vaut mieux rester.
Qu’en est-il de l’aide financière ?
On a coupé l’aide budgétaire au Mali. La politique extérieure est toujours faite de valeurs et d’intérêts. Si vous n’avez que des valeurs, vous devenez une ONG, si vous n’avez que des intérêts, vous devenez marchands d’armes. Nous ne sommes ni l’un, ni l’autre. Vis-à-vis des populations, nous travaillons sur les valeurs à long terme. Avec les gouvernements, nous travaillons sur les intérêts à plus court terme.
Face à des gouvernements comme ceux du Mali, du Burkina Faso, de la République centrafricaine ou de l’Ethiopie, on coupe les aides budgétaires. Mais on maintient les aides à la population, à condition que ce soit vraiment des aides à la population.
Au Mali ou en Centrafrique, l’intervention de l’Union européenne a contribué à reformer des armées qui ont ensuite tourné le dos à certains Etats membres ? Y a-t-il une leçon à en tirer ?
Si la France en particulier ne s’était pas engagée au Mali, au Tchad ou même au Niger, ces Etats se seraient désintégrés, la situation serait la même qu’en Libye. Imaginez les conséquences pour nous. Avoir assuré un minimum de stabilité politique jusqu’à présent, ce n’est pas rien. Evidemment, la lutte contre le terrorisme n’a pas été un succès et des régimes militaires qui préfèrent s’appuyer sur des mercenaires russes pour assurer leur pérennité au pouvoir sont apparus. Est-ce notre faute ? Non.
Vous évoquez les gouvernements mais on voit également de plus en plus de manifestations hostiles à la France au sein des populations… N’y a-t-il pas un problème dans la manière dont l’Europe s’adresse à elles ?
Je m’interroge sur l’intensité réelle du sentiment anti-français. Quand je vois un jeune Africain avec une pancarte disant « Poutine a sauvé le Donbass, maintenant il va nous sauver ! », quelle est la spontanéité de ce qu’il exprime ? La Russie déverse une énorme quantité de désinformation sur les populations africaines, en particulier au Sahel. Le message consiste à dire que la présence des armées occidentales est une prolongation cachée de la colonisation et qu’elles n’ont pas réussi à assurer la paix. Pour eux, la désinformation est une véritable industrie.
L’Europe en fait-elle assez dans cette bataille autour de l’information ?
Non. Certainement pas. On n’a pas mis les moyens. Les gens sont sensibles à la perception des faits mais aussi à leur explication. Nous sommes confrontés à une bataille des récits. Il faut qu’on ait une histoire à raconter parce que la Russie et la Chine en ont une et ils la racontent très bien.
Par exemple, quand on a commencé à lire : « On a faim, il n’y a pas de blé, pas de nourriture, pas d’énergie, c’est la faute des sanctions européennes. » C’est ce que dit la propagande russe, mais la réalité, c’est que l’armée russe a bloqué jusqu’à 20 millions de tonnes de blé ukrainien. N’est-ce pas suffisant pour savoir qui est coupable de quoi ? Nous ne nous sommes pas assez engagés dans la bataille contre la désinformation à ce sujet au départ. C’est plus équilibré maintenant, mais cette lutte va perdurer, il faut qu’on continue à expliquer, c’est la bataille pour la conquête des opinions publiques.
En Afrique du Sud, on a entendu Sergueï Lavrov répéter que le grain russe est bloqué en raison de sanctions financières prises contre la Russie.
Il peut dire ce qu’il veut, ce n’est pas vrai. J’ai demandé aux gouvernements africains de me signaler les problèmes rencontrés concrètement sur ce sujet pour essayer de les régler. Nous avons eu très peu de retours. En Afrique du Sud, le gouvernement n’a même pas évoqué le sujet lors de notre rencontre. Les sanctions sont faites pour gêner le système économique russe, mais nous avons fait tout notre possible pour que ça ne touche pas les engrais ni la nourriture.