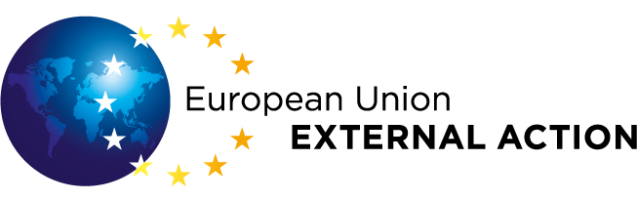Maroc: Discours d'ouverture du Haut représentant/Vice-président Josep Borrell aux étudiants à l'Université euro-méditerranéenne de Fès
Seul le texte prononcé fait foi !
Muchas gracias señor présidente [Mostapha Bousmina], merci beaucoup monsieur le Président de l’université. Merci Monsieur le chancelier, mon vieil ami [Mohamed] Kabbaj. Quand on discutait ensemble de la liaison fixe sur le détroit de Gibraltar entre l’Espagne et le Maroc, il y a un quart de siècle de ça Kabbaj ! Je suis ravi de vous revoir en bonne santé dans votre ville de Fès.
Monsieur le Président du Parlement, madame l’Ambassadrice de l’Union européenne [Patricia Llombart Cussac], comme on dit à Bruxelles, « tout protocole observé », je veux m’adresser surtout aux professeurs et aux étudiants de cette université.
Oui, vous avez raison, c’est la deuxième fois que j’ai l’honneur de participer à un acte académique dans cette université. J’en ai gardé un très bon souvenir et à l’occasion de mon voyage officiel au Maroc, j’ai demandé d'inclure la possibilité dans mon programme de revenir à Fès, ville historique du Maroc et dans cette université. Ça me fait un énorme plaisir et je vous en remercie.
Ça me fait énorme plaisir parce que, comme vous l'avez dit, monsieur le président [Mostapha Bousmina] je suis un académicien frustré ; on ne peut pas tout faire dans la vie. Et moi, j'ai commencé en tant que professeur à Madrid et j'ai trouvé un grand plaisir à enseigner les mathématiques à mes élèves. Et, à un moment donné, la démocratie est arrivée dans mon pays - l'Espagne - et j'ai été appelé au gouvernement par Felipe Gonzalez [ancien Président du gouvernement d'Espagne]. C'était pour quelques années et finalement ça a été pour le reste de ma vie.
Je le regrette. Je suis rentré trois ans à l'Institut universitaire européen de Florence, un centre d'excellence où on ne fait que des études de doctorat. [L’Institut est] niché dans les collines de Fiesole et surplombant Florence. Mais ce n'était pas pour enseigner, c'était pour diriger l’université - tâche difficile, vous le savez bien, parce que ce n'est pas toujours facile de gérer le monde académique.
On ne peut pas tout faire dans la vie et j'ai fait pas mal de choses, et je trouve quand même qu'il faut donner plus d'attention aux jeunes générations. Il faut investir plus dans l'éducation. L’éducation c’est tout. Le capital humain c’est le plus important des capitaux. Il y a des pays qui n'ont aucune ressource naturelle et ils sont très riches et très prospères parce qu'ils ont la chose la plus importante : le savoir-faire. Et pas seulement le savoir-faire en concret mais la capacité de comprendre, d'assimiler la connaissance, pas seulement de savoir, mais de savoir savoir.
Les personnes de l'université, ça m’a paru toujours un lieu d'excellence de l'être humain. L'Europe, c'est un pays des universités et elle a été bâtie autour de ses universités, comme le monde arabe aussi. Donc merci, merci pour ces quelques minutes avec vous. Heureux aussi de savoir que l'Union européenne a investi dans cette université qui est une réussite, peut-être la plus importante des réussites de l'Union pour la Méditerranée qui, malheureusement, n'a pas fait tout ce qu'elle devait faire et qui est dans un état un peu léthargique. Malheureusement parce que le bassin méditerranéen ne peut pas devenir une mer morte. Au contraire, il devrait devenir un lieu de fertilité pour faire le pont entre les deux rives.
Nous avons investi presque une centaine de millions d'euros pour soutenir cette initiative, pour financer la construction de son éco-campus ; récemment, pendant la pandémie de COVID19, pour fournir des ordinateurs portables, pour financer la construction de ces bâtiments grâce à un prêt de la Banque européenne d'investissement. Et nous serons heureux, Monsieur le Président [Mostapha Bousmina], monsieur le Chancelier [Mohamed Kabbaj], de continuer à vous aider dans vos projets, dans vos projets d’un centre hospitalo-universitaire, pour la recherche sur l'agriculture résiliente, ô combien importante dans un pays comme le Maroc qui vient de souffrir de la sécheresse la plus dure des dernières 40 années.
Quand je me déplace, je suis toujours heureux d'échanger avec vous, les étudiants et les professeurs. Donc ne voyez pas cette occasion comme un devoir de m'écouter, je suis surtout venu pour vous écouter, pour essayer de répondre à vos questions et pas seulement vos questions, vos commentaires. Vous n'avez pas besoin de poser des questions ; tout simplement dites-moi comment vous voyez les choses.
J’essaierai de pas être trop long pour laisser la place à la discussion et au partage. Mais inévitablement, je dois donner quelques coups de pinceau sur la difficile situation géopolitique du monde aujourd'hui, qui est la conséquence d'une guerre - une guerre qui a commencé le 24 février dernier – je m’en rappellerai toujours, ça fera partie de mon livre de mémoires - quand le téléphone a sonné à 5 h du matin et qu’une voix m'a dit: « Ils sont en train de bombarder Kyiv ».
On s'y attendait parce que quelques heures auparavant, le service d'intelligence nous avait déjà dit : « Ça va se passer ce weekend ». On l'attendait depuis quelques semaines. On ne le croyait pas, on ne voulait pas y croire ; moi, personnellement, je ne voulais pas y croire. Je ne voulais pas croire que, à nouveau, la guerre serait dans les frontières de l'Europe. Une véritable guerre - pas une guerre hybride, pas une guerre asymétrique - une véritable guerre entre deux armées conventionnelles qui font appel à toute la puissance de feu des armées modernes et qui reproduisent les décors et les scénarios des tranchées de 1914 et les massacres de 1939-45. On ne voulait pas y croire, mais malheureusement, le 24 [février] à l'aube, ils ont commencé à bombarder Kyiv.
Presque un an plus tard, ils continuent à bombarder Kyiv, et actuellement, la moitié de la population ukrainienne n'a pas d’accès à l'électricité. Vous pouvez bien imaginer ce que cela veut dire quand on habite dans la géographie et les climats ukrainiens.
Cela nous a plongé nous tous, dans un environnement stratégique radicalement différent de celui qu'on avait pu imaginer et qui nous a touché tous. Pas seulement les Ukrainiens, pas seulement les Européens, pas seulement les Méditerranéens, mais partout dans le monde. Parce que ça a provoqué une augmentation des prix de l'énergie, des denrées alimentaires qui ont mis dans des conditions très, très difficiles des centaines de millions de personnes.
Il s'agit sans doute de l'événement géopolitique le plus important de l'année dernière et je pense que ça sera l’événement le plus important des années à venir. Il s'agit d'une invasion qui viole les principes de base des Nations Unies, qui s'accompagne d’une multitude de crimes de guerre.
J'ai été dans les rues de Kyiv. Je peux vous dire que les voir en direct, ça vous choque. Mais ce n'est pas nécessairement que l’effet de voir en direct. Les chiffres sont terribles, le nombre de morts parmi les troupes d'un côté et de l'autre se comptent par dizaines de milliers, et on pourrait dire la même chose du nombre de civils.
Cette guerre a des conséquences négatives globales, augmente les tensions, l'alimentation et l'énergie, je l’ai déjà dit. Elles sont utilisées comme une arme de guerre. Pendant quelques mois, les exportations de blé de l'Ukraine ont été bloquées, plus de 20 millions de tonnes de blé n'ont pas pu sortir. Et si 20 millions de tonnes de blé ne peuvent pas être exportées, ça veut dire qu'il y a des millions de personnes qui ne peuvent pas manger. Après, grâce à un accord avec les Nations unies, on a été capable de commencer à faire sortir cette nourriture. Mais le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il y a trois cents millions de personnes dans 80 pays qui souffrent d'insécurité alimentaire. Et là, il y a un grand débat. C'est la faute à qui ? La Russie a dit : c'est la faute à vos sanctions. C'est la faute aux sanctions économiques qu'on a infligées à la Russie. Et je pense que c'est du mensonge éhonté parce que nos sanctions ne visent ni les produits alimentaires, ni les fertilisants. C'est l'armée russe qui a bloqué ces exportations, qui a bloqué les ports, les routes, qui a détruit les silos et qui empêchait cette énorme quantité de nourriture de rejoindre les marchés mondiaux.
Maintenant, on voit déjà que le prix du blé baisse et que le prix du gaz aussi. On revient à peu près à la situation d'avant-guerre. Mais pendant l'été, en Europe, on a payé le MegaWatt per hour d'électricité à plus de 300 euros, avant la guerre on le payait à 20. C'est à dire qu'on a multiplié par quinze le prix de l'électricité en quelques mois. Et ça, en Europe, on peut encore le payer, mais il y a beaucoup de pays dans le monde qui ne peuvent pas suivre cette incroyable poussée des prix. Les prix multipliés par dix et par quinze en quelques mois.
Ça s'inscrit dans un changement climatique et il est de plus en plus difficile, [ça] s'inscrit [aussi] sur les conséquences de la crise Covid, qu'on croyait surmontée. Mais est ce qu'elle est vraiment surmontée quand on voit ce qu'il se passe en Chine, quand on voit que dans les rues des villes chinoises, on brûle les cadavres dans la rue, parce qu'on ne sait pas quoi en faire ? Est ce qu'elle est vraiment surmontée la [crise] Covid ? Peut-être pas. En tout cas, nous avons des températures records, des inondations, des sécheresses ici au Maroc. Une augmentation du nombre des réfugiés dans le monde. La démocratie est en péril. L'émancipation des femmes et les droits humains sont menacés dans plusieurs régions du monde. Il y a beaucoup de pays qui font face à nouveau au piège de la dette, les taux d'intérêt montent, les conditions monétaires se resserrent et ça va toucher les pays émergents qui peuvent avoir à nouveau une crise de la dette. Et ça va toucher les pays développés qui vont voir les taux d'intérêt monter et la croissance diminuer.
Donc la guerre en Ukraine n'est pas le seul conflit. Il y en a beaucoup d'autres. Il est le plus médiatique. Mais n'oubliez pas l’Ethiopie, n'oubliez pas la Somalie, n'oubliez pas le Sahel. Ce sont des conflits qui ont coûté des dizaines de milliers de morts et dont on ne parle pas assez.
La Méditerranée, à l’exception du Maroc, est dans une situation d'instabilité préoccupante. Le Sahel aussi. Il y a trois ans, quand je suis allé à Bruxelles pour prendre mon job, le Sahel était relativement tranquille. Aujourd'hui, c'est la Russie qui prend le contrôle de la République centrafricaine, du Mali, peut-être du Burkina Faso. Et la menace terroriste se déplace vers le golfe de Guinée. La situation en Libye reste très tendue, difficile d'imaginer comment rétablir un État de droit dans ce pays. J'ai déjà cité l’Ethiopie et la Corne de l'Afrique, mais je pourrais parler du Liban, un pays qui n'arrête pas de tomber. Comme dit déjà, il était aux abois, et le lendemain, la situation est encore pire. Nous avons des menaces dans le détroit de Taïwan et en Corée du Nord. Donc l'inventaire des crises serait long et il faudra peut-être se concentrer, nous et nos partenaires, et en particulier les Marocains, sur la façon d'y faire face.
Je sais que beaucoup de nos partenaires sont marqués par l'histoire du colonialisme. Et je sais que parfois, quand je critique la Russie, la réponse, c'est l'accusation de double standard pour les Européens. Et c'est vrai. C'est vrai que nous ne sommes pas innocents, que la guerre en Irak, c'est aussi une initiative malheureuse qui nous place dans une situation difficile, au moment où l’on dit que quelques-uns utilisent la violence en dehors du cadre des Nations unies. Je sais qu'il y a des pays qui sont sensibles à la propagande russe, même si la guerre contre l'Ukraine est un cas typiquement pur d’une agression impérialiste qui a aussi un réflexe colonial. Mais je voudrais vous dire que cette violation de la Charte des Nations unies, demande du monde entier une réponse ferme. Nous, les Européens, nous avons essayé de le faire et je peux vous dire qu'aujourd'hui, l'Union européenne a investi pour aider l'Ukraine 44 milliards d'euros. C'est un chiffre énorme. D'une façon ou d'une autre, on est aux alentours des 44 milliards d'euros dépensés en moins d'un an. Pas seulement en aide militaire mais en aide civile, aide humanitaire, aide macro-financière. Mais oui, sans doute, aussi du point de vue militaire.
On a été capables d'enlever notre dépendance énergétique de la Russie. Au début de la guerre, l'Europe recevait 40 % de son gaz de la Russie, une dépendance énorme. Aujourd'hui, on est pratiquement à zéro. Et c'est quelque chose que sans doute [Vladimir] Poutine ne pensait pas. Il croyait qu'il pouvait faire du chantage avec son énergie, mais on a été capable d'aller chercher du gaz, du charbon ou du pétrole dans d'autres pays, d’économiser, d'en consommer moins et aujourd'hui, on est libre de la dépendance énergétique de la Russie.
Ça ne s'est pas passé sans problème et je sais que quand les Européens sont allés acheter du gaz, ils ont fait monter les prix du gaz et que d'autres pays en ont souffert les conséquences. Il n'y a rien sans rien dans le monde. Mais c'est vrai que ces difficultés économiques et sociales, nous devons faire face parce qu'il y a une épreuve de force qu'il faut gagner, qu'il faut gagner non seulement pour la paix en Europe, mais pour défendre un ordre international basé sur des règles.
Et ça, c'est aussi une bonne occasion pour développer nos liens avec d'autres pays, notamment en Afrique, pour remplacer les énergies fossiles par d'autres et l'énorme potentiel qu’a le Maroc justifie à lui tout seul l'existence d'une université avec sa branche technologique et qui je sais dédie beaucoup de temps et d'efforts aux énergies renouvelables.
Mais n'oublions pas la Chine. La Chine et sa montée en puissance, c'est peut-être l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité dans ce siècle. En 40 ans, la Chine a été capable de faire quelque chose d’inouïe et son développement, faire sortir de la pauvreté des centaines de millions de personnes et devenir un leader technologique, économique et même militaire, c'est quelque chose de remarquable qui doit nous faire prendre en compte du Pacifique.
La Chine a été pour nous un énorme marché, la Chine a été un des relais de notre croissance. La Chine est aujourd'hui un compétiteur, est un partenaire, est un rival. C'est beaucoup de choses à la fois. Elle n'est plus la fabricante de produits bon marché - et sans valeur ajoutée. Au lieu de cela la Chine est à la pointe de la technologie, est un rival systémique, est un compétiteur économique. Mais à la fois il faut qu'on établisse avec la Chine des liens, des partenariats parce que sans la Chine, on ne peut résoudre aucun des problèmes du monde.
La Chine brûle à elle toute seule autant de charbon que le reste du monde ensemble. Donc comment résoudre le problème du changement climatique sans un engagement fort de la part de la Chine ?
Mais la Chine demande aussi sa place dans le monde. Et d'autres pays émergeants demandent un rôle dans un ordre mondial qui n'est pas du tout celui de 1945. Il y a des pays comme l'Afrique du Sud, l'Inde, le Brésil, le Nigeria, le Pakistan, ils sont là, énormes, avec des populations croissantes, avec des ressources qui seront de plus en plus importantes. Il faut refaire le monde à la hauteur d'aujourd'hui et pas à l'ombre d’hier. Et notre monde est encore aujourd'hui bâti à l'ombre d’hier. Et c'est normal qu'il y ait des pays qui demandent leur place et nous devrions être capables de regarder le monde - nous Européens - avec une vision moins euro centrique, parce qu’on n'est plus le centre du monde, on est seulement les 5 % de la population mondiale. Et on devrait être capable de faire un énorme effort de partenariat pour venir non pas « en aide de » mais « à la coopération avec » de façon à établir les équilibres qui empêchent les flux migratoires irréguliers avec toute la souffrance humaine que ça représente, et un développement plus juste.
Pour cela, il faudra faire appel à la technologie, je suis un ingénieur de formation et je sais qu'il y a beaucoup de problèmes que la technologie a créés et que seulement la technologie résoudra.
Dans le domaine de l'énergie, sans doute, je vous pose un exemple: on discute beaucoup de l'hydrogène vert; tout le monde en parle. C'est le nouveau Graal, l'hydrogène vert. Oui, d'accord, mais il faudra le transporter. [On nous dit] : « Mais on a les réseaux des pipelines de gaz ». C’est pas sûr que les réseaux des pipelines de gaz soient capables de transporter l'hydrogène vert. C'est un gaz différent, beaucoup plus léger et beaucoup plus inflammable. Je pose une question à la branche technologique de cette université: comment faire pour utiliser les réseaux de pipelines de gaz à partir du moment où il n'y aura pas de gaz, ou on ne voudra pas vivre du gaz. Est ce qu'ils sont utilisables pour un autre but ou ils ne sont pas ? Et qu'est-ce qu'il faut faire alors?
On sait que le Maroc pousse pour un grand projet de gazoduc du Nigeria à l’Europe, en contournant toute la façade atlantique de l'Afrique. Le ministre [des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger Nasser] Bourita me disait hier que ça serait un projet fédérateur parce que tous les pays africains seraient concernés, en feraient partie. Oui, mais il faut faire le compte quand il sera fini, est-ce qu'on va encore vouloir utiliser des gaz, du méthane ou ce qu'on voudra utiliser l’hydrogène ? Et le Maroc sera sans doute, avec les vents et le soleil, que vous avez un grand producteur d'hydrogène. Mais comment le transporter ? Il y a là des questions fondamentales auxquelles seulement les ingénieurs peuvent répondre et qui vont conditionner la géopolitique mondiale.
Je m'arrête là. Je pense que j'ai mis sur la table un certain nombre de questions sur lesquelles je serai heureux de dialoguer avec vous, de recevoir des opinions, vos points de vue, vos critiques - pas trop, mais quand même. En tout cas, merci beaucoup de votre attention.
Lien vers la vidéo: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-235697