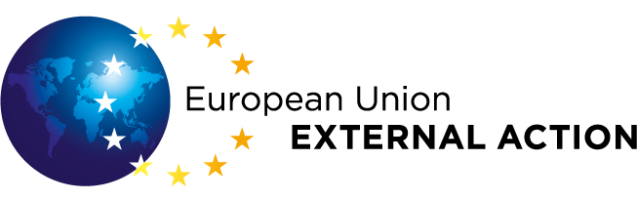Passage en revue de 2021: une année de transitions

«2021 aura été une année de transitions. Les changements géopolitiques se sont intensifiés et les politiques de rapports de force n’ont eu de cesse de défier l’UE et les valeurs qui sont les nôtres.»
La pandémie a continué de sévir, au-delà de ce que nous aurions imaginé il y a un an, et le variant omicron réclame à son tour la mise en place de restrictions majeures, mettant ainsi en péril la reprise. Nous savons toutefois que les vaccins ont un effet décisif. Grâce au mécanisme d’achat commun, la majorité des Européens ont désormais reçu au moins deux doses. Depuis décembre 2020, l’UE exporte aussi des vaccins contre la COVID-19, et ce sans interruption. Sur un total de deux milliards de doses produites, l’UE a exporté plus de 1,1 milliard de doses vers 61 pays et Team Europe a diffusé plus de 385 millions de doses. L’UE a ainsi dépassé son objectif pour 2021, qui consistait à avoir diffusé 250 millions de doses avant la fin de l’année, Team Europe ayant quant à elle pour but de faire don de 700 millions de doses d’ici la fin du premier semestre 2022.
«Nous devons faire plus encore afin de remédier aux disparités en matière de vaccination et de lutter contre des déséquilibres et des inégalités qui vont croissant.»
Il n’empêche que l’inégalité constatée entre les taux de vaccination sur les différents continents souligne la nécessité d’accélérer les donations et de développer des capacités de production de vaccins locales, notamment en Afrique. En réalité, tandis qu’en Europe, 60 % de la population est complètement vaccinée (UE: 68 %), les taux de vaccination complète se situent à 61 % en Amérique du Sud, 56 % en Amérique du Nord/Amérique centrale et dans les Caraïbes, 57 % en Océanie, 53 % en Asie et seulement 8 % en Afrique. En tête de ces disparités vient le fait que la pandémie a donné un coup d’arrêt au rattrapage des pays en développement, ce qui a eu pour effet d’accroître la faim et la pauvreté dans le monde, la Banque mondiale estimant à environ 150 millions le nombre de personnes tombées en dessous du seuil de pauvreté en raison de la COVID. Nous devons faire plus encore afin d’inverser cette tendance et de lutter contre des déséquilibres et des inégalités qui vont croissant.
En plus de la pandémie à gérer, nous avons eu à courir d’une crise à l’autre, l’ordre du jour international et de l’UE étant dominé par l’actualité en Biélorussie, en Ukraine, au Mali, au Soudan, en Afghanistan, en Éthiopie et au Venezuela. Le fait d’être en permanence en mode de gestion de crises a parfois amoindri notre capacité à faire face à des problèmes transversaux de longue haleine qui demanderaient pourtant à figurer au centre de notre politique étrangère, tels que la nécessité de revitaliser le multilatéralisme, de gérer les migrations de manière équilibrée, de remédier aux crises de l’énergie et du climat ou encore de fixer des règles en matière de transition numérique.
«Le fait d’être en permanence en mode de gestion de crises a parfois amoindri notre capacité à faire face à des problèmes transversaux de longue haleine.»
Bien que nous ayons essuyé nombre de revers et été aux prises avec bien des difficultés en 2021, nous avons aussi connu certaines évolutions positives. Ainsi, nous avons pu présenter la boussole stratégique aux États membres de l’UE. Son objectif est de renforcer le rôle de l’UE en tant que garant de la sécurité. Jusqu’à présent, les Européens ont trop souvent vécu dans une «bulle sécuritaire», en dépit de la rapide détérioration de la situation sur le plan de la sécurité. Si l’UE n’a pas vocation à être une puissance militaire comme on l’entend traditionnellement, nous devons néanmoins être mieux à même de nous défendre. La boussole devrait être adoptée au mois de mars prochain et nous permettre de prendre notre sécurité et notre défense plus au sérieux.
Un autre exemple allant dans le bon sens est la manière dont la diplomatie climatique de l’UE a montré la voie dans la lutte contre le changement climatique lors de la COP26 à Glasgow. Lorsque l’on doit négocier avec 197 parties différentes, les compromis sont de mise et l’UE a joué son rôle, par exemple en étant à l’initiative de l’engagement mondial concernant le méthane, finalement signé par 100 pays.
«La boussole stratégique devrait nous permettre de prendre notre sécurité et notre défense plus au sérieux.»
2021 a également vu la reprise des relations UE-États-Unis, sous la présidence Biden. La nouvelle direction de l’administration américaine nous a permis de progresser, par exemple, sur la lutte contre le changement climatique, sur les négociations relatives au nucléaire iranien et sur la fiscalité des entreprises. Si le départ d’Afghanistan et la mise en œuvre de la décision AUKUS se sont déroulés de manière malheureuse, à la fin de l’année, en revanche, nous avons tenu d’étroites consultations UE-États-unis sur la Chine et la région indo-pacifique et nous sommes également convenus de lancer un dialogue UE-États-unis spécialement consacré à la sécurité et à la défense.
Nous avons renforcé cette année notre engagement aux côtés de l’Amérique latine, avec notamment la première visite à haut niveau de l’UE au Brésil en neuf ans et l’inauguration du câble sous-marin en fibre optique EllaLink entre l’UE et le Brésil. La réunion de début décembre entre dirigeants de l’UE, de l’Amérique latine et des Caraïbes devrait aussi favoriser de nouvelles avancées dans les mois à venir.
En ce qui concerne la Chine, nous avons maintenu l’unité de l’UE, en reconnaissant que l’UE voyait dans ce pays à la fois un partenaire, un concurrent et un rival systémique. En 2021, la dégradation de la situation des droits de l’homme en Chine, son comportement régional, la décision de sanctionner les parlementaires et d’autres organes officiels de l’UE, ainsi que, plus récemment, la coercition exercée à l’encontre de la Lituanie ont laissé des traces.
De manière générale, nous avons mis l’accent sur la diversification de nos partenariats avec tous les pays de la région indo-pacifique. Notre nouvelle stratégie indo-pacifique (lien externe) promeut l’engagement de l’UE vis-à-vis de cette région à ne pas uniquement renforcer les échanges et l’investissement, mais aussi à coopérer davantage sur les questions de sécurité, par exemple en matière de sécurité maritime et de cybersécurité. Ma visite à Jakarta au mois de juin a consolidé notre engagement avec l’ASEAN. Nous avons également engagé un dialogue plus approfondi avec l’Asie centrale et commencé à améliorer notre coopération avec les pays du Golfe.
En Afrique, l’année 2021 a hélas été marquée par une multitude de conflits et par la détérioration générale de la situation au Sahel. La guerre civile en Éthiopie, notamment, a pris une dimension dramatique. Nous préparons en ce moment le sommet UA-UE, qui se tiendra en février et au cours duquel l’UE devra passer des paroles aux actes, notamment pour ce qui est des vaccins et du financement de l'action climatique.
La situation en Libye semble s’être stabilisée après le nouveau report des élections et une tendance à l'atténuation, cette année, des tensions avec la Turquie en Méditerranée orientale. Le Forum régional de l’Union pour la Méditerranée et la conférence ministérielle du voisinage méridional de l’UE qui se sont tenus récemment à Barcelone, à la fin du mois de novembre, nous ont aussi rappelé combien il était urgent de combler le fossé grandissant entre les deux rives de la Méditerranée et de saisir les nouvelles possibilités qui s’offrent à nous, par exemple autour du thème de la transition verte.
«En 2021,année de transitions, nous avons œuvré à la défense des intérêts et des valeurs de l’UE et renforcé un ordre international fondé sur des règles.»
Dans notre partenariat oriental, 2021 a été témoin de l’expression de politiques clairement fondées sur les rapports de force, ainsi que nous l’avons vu dans les cas de l’Ukraine, de la Biélorussie et de la Moldavie. Pour faire face à ces menaces, l’UE a apporté à ses partenaires un soutien aussi bien politique qu’opérationnel, en faisant montre de fermeté et d’unité, notamment en adoptant le 5e train de sanctions à l’encontre du régime de Loukachenko, en Biélorussie. Alors que l’on assiste à la prolifération des conflits hybrides, nous devons continuer à aider l’Ukraine ou la Moldavie à résister aux pressions de Moscou, et maintenir une approche inflexible à l’égard de la Biélorussie. À cet égard, le sommet du partenariat oriental a réaffirmé la démarche à la fois stratégique, ambitieuse et orientée vers l'avenir de l’UE vis-à-vis de nos partenaires d’Europe de l’Est. La montée des rhétoriques et des actes de nature à créer des divisions au sein des Balkans occidentaux, en particulier en Bosnie-Herzégovine, a également entravé les efforts consentis pour rapprocher les six pays de la région de leur avenir européen.
Cet aperçu de l’an passé n’est en rien exhaustif, mais je tenais à en rappeler certains des aspects les plus remarquables. En 2021, année de transitions, nous avons œuvré à la défense des intérêts et des valeurs de l’UE et renforcé un ordre international fondé sur des règles. Il nous appartient de poursuivre ce travail en 2022 avec toute la détermination voulue.